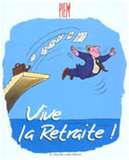
Repousser l'âge légal au-delà de 60 ans et allonger la durée de cotisation de 41 à 41,5 ans. Pour faire reculer l'âge effectif de départ en retraite, le gouvernement voudrait agir sur ces deux paramètres à la fois.
C'est un scénario central sur lequel planche le gouvernement, même si rien n'est arrêté et si de très nombreux curseurs restent à fixer. Pour faire reculer l'âge effectif de départ en retraite des salariés du privé et du public, l'exécutif compte agir sur deux paramètres à la fois : l'âge légal et la durée de cotisation.
La durée de cotisation est actuellement relevée d'un trimestre par an, pour atteindre 41 ans en 2012, en vertu de la loi Fillon. Le raisonnement acté en 2003 était le suivant : jusqu'à 2020, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein augmentera d'un tiers du gain d'espérance de vie à 60 ans. Cela devrait conduire à une durée de cotisation de 41,5 ans en 2020 si les prévisions démographiques se vérifient.
Deux âges légaux
60 ans. C'est l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. Pour bénéficier d'une retraite sans décote, il faut travailler jusqu'à 60 ans et avoir cotisé un certain nombre d'années (41 ans pour les salariés nés en 1952, qui auront 60 ans en 2012). Un départ anticipé à taux plein avant 60 ans est prévu pour les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes. Dans la fonction publique, l'ouverture des droits est possible avant 60 ans pour certaines professions comme les infirmières (lire ci-dessous). 61 ans et demi. C'est l'âge moyen auquel les salariés du privé sont effectivement partis à la retraite en 2009. Dans la fonction publique, l'âge moyen effectif était de 59 ans et cinq mois en 2008. 65 ans. C'est l'âge légal du taux plein. Quelle que soit sa durée de cotisation, un salarié peut partir avec une pension sans décote à cet âge.
Le gouvernement n'envisagerait pas d'accélérer ce rythme. Il devrait en revanche proposer de prolonger la règle " deux tiers-un tiers " au-delà de 2020. " Ce principe est équitable ", souligne une source gouvernementale. L'effet serait important à long terme, car la durée de cotisation pourrait atteindre 43 à 44 ans d'ici à 2050.
Des économies rapidement
Mais cela ne sera d'aucune utilité pour rétablir l'équilibre à court terme, alors que le besoin de financement des régimes dépasse 25 milliards d'euros. François Fillon a admis que la réforme de 2003 n'a pas eu suffisamment d'effet sur les comportements. L'âge effectif du départ dans le privé (61,5 ans) n'a pas bougé. Dans le public, la remontée est plus rapide, mais l'âge moyen reste inférieur à 60 ans.
Autant de raisons qui poussent le gouvernement à relever l'âge légal de départ sans pénalité, fixé à 60 ans depuis 1982 (lire ci-contre). " Sans aucun doute il faudra toucher à ce curseur, ce n'est pas un secret que de le dire ", a déclaré le ministre du Travail, Xavier Darcos. Cela relèvera immédiatement l'âge effectif du départ - même si le mouvement ne pourra se faire que progressivement, par exemple d'un trimestre par an. Et cela permettra de réaliser des économies assez rapidement : le Conseil d'orientation des retraites avait chiffré à 6,6 milliards d'euros le gain à l'horizon 2020 d'un passage à 62 ans (effectif en 2016).
Des études plus longues
Reste à savoir à quel niveau remonter l'âge légal. Pour cela, le gouvernement pourrait raisonner à partir de l'âge moyen auquel les assurés commencent à cotiser pour leur retraite. Celui-ci a sensiblement progressé, en raison de l'allongement de la durée des études et du fort taux de chômage des jeunes. Pour les personnes nées en 1970, cet âge moyen est compris entre 22 ans et 22 ans et demi. Précisément, il s'agit de l'âge moyen auquel cette génération a validé ses quatre premiers trimestres (voir graphique). Si l'on ajoute les 41 années de cotisations nécessaires, cela signifie que ces personnes, âgées aujourd'hui de 40 ans, ne pourraient de toute façon pas bénéficier d'une retraite à taux plein avant 63 ans ou 63 ans et demi avec la réglementation en vigueur. Relever l'âge légal à ce niveau aurait donc une certaine logique... " Les personnes nées en 1970 auront besoin de 164 trimestres (soit 41 ans) au moins selon la législation actuelle " afin d'obtenir une pension complète, souligne la Drees dans une étude récente. Avec 30 trimestres validés à 30 ans, elles " pourront au mieux partir en moyenne à 63 ans et demi (sans régularisation, ni rachat ou majoration) " .
Une autre question épineuse va se poser : relever la " borne " des 60 ans devrait conduire logiquement à relever l'autre âge légal de 65 ans, à partir duquel un salarié peut partir sans décote même s'il n'a pas suffisamment cotisé. Dans le cas contraire, le risque serait de concentrer les départs entre deux bornes devenues trop rapprochées. En outre, le relèvement de la borne de 65 ans générerait plus de gains à long terme que celle de 60 ans. Mais cela signifierait pour les salariés ayant commencé à travailler tard ou ayant eu des carrières incomplètes (notamment les femmes) que la retraite ne serait pas possible avant un âge très élevé. De quoi faire hésiter le gouvernement.

 Accueil
Accueil








