
1. A qui la faute ?
«Le dérèglement est en marche, il n'y a aucun doute, on est au début du processus», déclare Hervé Le Treut (Laboratoire de météorologie dynamique du CNRS) à la fin de la canicule de ce mois de juillet 2006. Une pareille déclaration apparaît très nouvelle, car jusqu'ici les spécialistes se refusaient à admettre un lien direct de causalité entre tel ou tel événement météorologique particulier et l'évolution générale du climat. Ils vous renvoyaient plutôt aux statistiques, constatant que l'histoire du monde a, de toute façon, toujours été émaillée de tornades, cyclones, canicules, sécheresses ou inondations. Cette réserve n'est donc plus de mise. Auparavant, il avait déjà été difficile d'admettre que l'homme était responsable du réchauffement constaté, aujourd'hui qualifié d'anthropique. La masse corporelle totale des 6 milliards d'humains est en effet environ 50 fois inférieure à celle des seuls vers de terre, alors comment croire que nous étions capables de modifier le climat, nous qui, tous debout au coude à coude, pourrions tenir sur un territoire aussi minuscule que celui de Hongkong ? Et pourtant aujourd'hui le doute n'est plus permis. Nul n'ose plus contester que, via les émissions de gaz à effet de serre dont surtout le CO2, «le climat se réchauffe à cause de l'effet de serre provoqué par les activités humaines», insiste Jean Jouzel, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il nous faut donc nous débrouiller avec les conséquences de nos erreurs... et avec la multiplication des canicules.
2. Le phénomène est-il prévisible?
Il y a toujours eu des épisodes caniculaires et, jusqu'à nouvel ordre, leur prévision demeure impossible. Après la canicule d'août 2003, les spécialistes avaient réexaminé tous leurs modèles climatiques. Ils les avaient refait tourner en flash-back, après les avoir gavés de toutes sortes de données réelles disponibles avant. Et ils avaient dû en conclure qu'aucun de ces modèles n'était en mesure de rien voir venir plus de trois ou quatre jours à l'avance. Hélas, on en est toujours au même point, et au moment où ils annonçaient la fin de la canicule de juillet, les météorologues se reconnaissaient incapables de jurer qu'il n'y en aurait pas une autre dans la foulée, une petite semaine plus tard. En revanche, les climatologues et les prévisionnistes ne se gênent pas pour nous affirmer que, d'une façon statistique, l'avenir sera chaud. Et que les canicules - aux dates de déclenchement toujours indéterminables - deviendront à la fois plus fréquentes et plus longues. Pour Hervé Le Treut,«à l'horizon 2050, les canicules extrêmes, du type de celle de 2003, reviendront assez fréquemment, par exemple tous les deux ou trois ans». De 1960 à 1989, la moyenne annuelle de jours caniculaires s'était établie pour la France à 3. Ortous les modèles voient ce chiffre passer à 10 avant le milieu du siècle. Il va falloir s'habituer à transpirer.
2. Le phénomène est-il prévisible?
Il y a toujours eu des épisodes caniculaires et, jusqu'à nouvel ordre, leur prévision demeure impossible. Après la canicule d'août 2003, les spécialistes avaient réexaminé tous leurs modèles climatiques. Ils les avaient refait tourner en flash-back, après les avoir gavés de toutes sortes de données réelles disponibles avant. Et ils avaient dû en conclure qu'aucun de ces modèles n'était en mesure de rien voir venir plus de trois ou quatre jours à l'avance. Hélas, on en est toujours au même point, et au moment où ils annonçaient la fin de la canicule de juillet, les météorologues se reconnaissaient incapables de jurer qu'il n'y en aurait pas une autre dans la foulée, une petite semaine plus tard. En revanche, les climatologues et les prévisionnistes ne se gênent pas pour nous affirmer que, d'une façon statistique, l'avenir sera chaud. Et que les canicules - aux dates de déclenchement toujours indéterminables - deviendront à la fois plus fréquentes et plus longues. Pour Hervé Le Treut,«à l'horizon 2050, les canicules extrêmes, du type de celle de 2003, reviendront assez fréquemment, par exemple tous les deux ou trois ans». De 1960 à 1989, la moyenne annuelle de jours caniculaires s'était établie pour la France à 3. Ortous les modèles voient ce chiffre passer à 10 avant le milieu du siècle. Il va falloir s'habituer à transpirer.
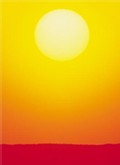
3. Notre organisme peut-il s'adapter ?
Huit jours, c'est à peu près le temps nécessaire à l'homme pour se faire aux grosses chaleurs. Comme les autres mammifères et les oiseaux, il est équipé d'un thermostat interne, situé au niveau de l'hypothalamus et chargé de maintenir sa température interne à 37°. Le corps peut résister jusqu'à 41° environ, au maximum 8 heures. Au-delà, les infrastructures cellulaires explosent, à 50 °C, la vie s'arrête en moins de 5 minutes.
Scénario rarissime, heureusement, car l'organisme se défend dès les premières sensations de chaleur. Le coeur s'emballe, comme le débit sanguin (qui peut augmenter jusqu'à 20 litres à la minute), la vasodilatation cutanée permet de détourner le sang de la circulation profonde vers la surface de la peau... La clim interne peut alors tourner à plein régime. Le corps, qui est composé environ de deux tiers d'eau (75% chez un nouveau-né et environ 55% chez une personne âgée) n'a qu'un seul moyen réellement efficace de se refroidir : transpirer. Dans des conditions normales, il évacue 500 ml d'eau par 24 heures, en cas de canicule, il peut aller jusqu'à 1 litre par heure, et même plus de 3,5 litres/heure, exploit resté célèbre d'un marathonien aux JO de 1984.
Au fil du temps, le corps est plus efficace, la sudation plus précoce, plus abondante, avec une concentration réduite en sel, et une vasodilatation cutanée qui se déclenche plus rapidement... Ainsi, ceux qui vivent sous les tropiques souffrent beaucoup moins des grosses chaleurs que les Scandinaves, leur organisme s'est acclimaté grâce aussi à d'autres habitudes de vie : vêtements de coton, sieste, alimentation plus légère... Nous le ressentons tous : la chaleur diminue l'appétit. Impression confirmée par toutes les enquêtes : on mange moins dans les pays chauds, pas seulement parce le niveau de vie y est souvent moins élevé. Les Belges, par exemple, absorbent 50% de calories par jour de plus que les habitants des Bermudes. Rien d'étonnant, puisque 80% de ce que l'on consomme quotidiennement sert juste à maintenir la température du corps. Dans le monde fournaise qui nous attend, les pâtissiers et les marchands de régimes amaigrissants vont faire la gueule...
Aucun chercheur, en revanche, ne s'est, pour l'instant, intéressé aux effets de la chaleur sur la libido des humains. On sait simplement qu'elle est peut-être bonne pour le moral. Des études ont montré que plus les hommes vivent dans des climats chauds, plus ils ont des niveaux élevés de sérotonine, une hormone cérébrale apparemment efficace contre les troubles de l'humeur, comme la violence et la dépression... Avec un peu de chance, le réchauffement climatique fera aussi baisser notre consommation d'anxiolytiques.
4. Faut-il modifier notre façon de travailler ?
Après les personnes âgées en 2003, les travailleurs en 2006. Cette année, la canicule a attiré l'attention sur les conditions de travail de certaines professions. Premiers visés, les salariés du BTP. Ils ont payé le plus lourd tribut à la chaleur avec, fin juillet, déjà cinq personnes décédées suite à un coup de chaleur. Quant aux salariés du magasin Fabbio Lucci d'Alès, dans le Gard, ils ont, par leur grève, révélé le malaise des vendeurs dans les commerces non climatisés : «Il faisait 40° dans la boutique, jusqu'à 43° dans la réserve. Les clients qui entraient faisaient demi-tour immédiatement», explique l'un des salariés, qui souligne le soutien apporté par ces clients avec 2000 signatures de solidarité.
Faudra-t-il à terme revoir notre façon de travailler, réécrire le Code du Travail pour s'adapter à la nouvelle donne climatique ? Pour ce qui est du rythme de travail, probablement oui. Des mesures ont déjà été mises en oeuvre par le gouvernement, qui incite les professionnels du BTP à faire débuter les chantiers plus tôt dans la journée afin d'éviter les fortes chaleurs de l'après-midi. Une mesure qui aura des conséquences pour toute la société, qui devra accepter d'être réveillée plus tôt par le bruit des chantiers, avec l'accord des maires qui devraient prendre des arrêtés en ce sens, et s'accommoder d'un allongement des délais pour la livraison des travaux. Dans l'industrie et les bureaux, les recherches menées par l'INRS (Institut national de Recherche et de Sécurité) portent surtout sur la conception des bâtiments, leur thermorégulation, avec des procédés architecturaux permettant de limiter les effets de l'ensoleillement.
Quant à réécrire le Code du Travail, selon Giles Heude de l'Anact (Agence nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail), ce ne sera pas forcément nécessaire : «La réglementation actuelle est complète et cohérente, notamment grâce à l'article L 230-2, qui fait obligation aux employeurs de mettre en place des mesures garantissant la sécurité des travailleurs.» Pour lui, l'adaptation à la nouvelle donne climatique est «plus une affaire de bons sens que de règlement». Les syndicats, à l'exemple de la CGT chez Fabbio Lucci, ne semblent pas toujours persuadés que le bon sens suffise.
Scénario rarissime, heureusement, car l'organisme se défend dès les premières sensations de chaleur. Le coeur s'emballe, comme le débit sanguin (qui peut augmenter jusqu'à 20 litres à la minute), la vasodilatation cutanée permet de détourner le sang de la circulation profonde vers la surface de la peau... La clim interne peut alors tourner à plein régime. Le corps, qui est composé environ de deux tiers d'eau (75% chez un nouveau-né et environ 55% chez une personne âgée) n'a qu'un seul moyen réellement efficace de se refroidir : transpirer. Dans des conditions normales, il évacue 500 ml d'eau par 24 heures, en cas de canicule, il peut aller jusqu'à 1 litre par heure, et même plus de 3,5 litres/heure, exploit resté célèbre d'un marathonien aux JO de 1984.
Au fil du temps, le corps est plus efficace, la sudation plus précoce, plus abondante, avec une concentration réduite en sel, et une vasodilatation cutanée qui se déclenche plus rapidement... Ainsi, ceux qui vivent sous les tropiques souffrent beaucoup moins des grosses chaleurs que les Scandinaves, leur organisme s'est acclimaté grâce aussi à d'autres habitudes de vie : vêtements de coton, sieste, alimentation plus légère... Nous le ressentons tous : la chaleur diminue l'appétit. Impression confirmée par toutes les enquêtes : on mange moins dans les pays chauds, pas seulement parce le niveau de vie y est souvent moins élevé. Les Belges, par exemple, absorbent 50% de calories par jour de plus que les habitants des Bermudes. Rien d'étonnant, puisque 80% de ce que l'on consomme quotidiennement sert juste à maintenir la température du corps. Dans le monde fournaise qui nous attend, les pâtissiers et les marchands de régimes amaigrissants vont faire la gueule...
Aucun chercheur, en revanche, ne s'est, pour l'instant, intéressé aux effets de la chaleur sur la libido des humains. On sait simplement qu'elle est peut-être bonne pour le moral. Des études ont montré que plus les hommes vivent dans des climats chauds, plus ils ont des niveaux élevés de sérotonine, une hormone cérébrale apparemment efficace contre les troubles de l'humeur, comme la violence et la dépression... Avec un peu de chance, le réchauffement climatique fera aussi baisser notre consommation d'anxiolytiques.
4. Faut-il modifier notre façon de travailler ?
Après les personnes âgées en 2003, les travailleurs en 2006. Cette année, la canicule a attiré l'attention sur les conditions de travail de certaines professions. Premiers visés, les salariés du BTP. Ils ont payé le plus lourd tribut à la chaleur avec, fin juillet, déjà cinq personnes décédées suite à un coup de chaleur. Quant aux salariés du magasin Fabbio Lucci d'Alès, dans le Gard, ils ont, par leur grève, révélé le malaise des vendeurs dans les commerces non climatisés : «Il faisait 40° dans la boutique, jusqu'à 43° dans la réserve. Les clients qui entraient faisaient demi-tour immédiatement», explique l'un des salariés, qui souligne le soutien apporté par ces clients avec 2000 signatures de solidarité.
Faudra-t-il à terme revoir notre façon de travailler, réécrire le Code du Travail pour s'adapter à la nouvelle donne climatique ? Pour ce qui est du rythme de travail, probablement oui. Des mesures ont déjà été mises en oeuvre par le gouvernement, qui incite les professionnels du BTP à faire débuter les chantiers plus tôt dans la journée afin d'éviter les fortes chaleurs de l'après-midi. Une mesure qui aura des conséquences pour toute la société, qui devra accepter d'être réveillée plus tôt par le bruit des chantiers, avec l'accord des maires qui devraient prendre des arrêtés en ce sens, et s'accommoder d'un allongement des délais pour la livraison des travaux. Dans l'industrie et les bureaux, les recherches menées par l'INRS (Institut national de Recherche et de Sécurité) portent surtout sur la conception des bâtiments, leur thermorégulation, avec des procédés architecturaux permettant de limiter les effets de l'ensoleillement.
Quant à réécrire le Code du Travail, selon Giles Heude de l'Anact (Agence nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail), ce ne sera pas forcément nécessaire : «La réglementation actuelle est complète et cohérente, notamment grâce à l'article L 230-2, qui fait obligation aux employeurs de mettre en place des mesures garantissant la sécurité des travailleurs.» Pour lui, l'adaptation à la nouvelle donne climatique est «plus une affaire de bons sens que de règlement». Les syndicats, à l'exemple de la CGT chez Fabbio Lucci, ne semblent pas toujours persuadés que le bon sens suffise.

5. Sommes-nous condamnés à la clim ?
«La clim auto pour seulement 1 euro de plus!» C'est l'offre alléchante que proposent certains constructeurs pendant l'été. Une offre qui séduit 3 acheteurs sur 4 en France. A ce rythme, ce chiffre pourrait atteindre 9 sur 10 en 2010 ! Idem pour les logements. Depuis la canicule de 2003, les climatiseurs fixes et mobiles ont vu leurs ventes décoller de plus de 40%. Si, pour l'instant, seuls 10% des foyers français en sont équipés, ce chiffre atteint 70% aux Etats-Unis et 90% au Japon. Une perspective qui fait frémir les spécialistes de l'environnement. «La climatisation à outrance a deux effets : d'abord une surconsommation d'énergie, qui atteint 15 à 20% de plus pour les voitures climatisées, prévient Matthieu Orphelin, de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie); ensuite, la fuite dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, qui sont de dangereux gaz à effet de serre. Un gramme rejeté équivaut à 1,3 kilo de gaz carbonique!» Ainsi, en cherchant à se prémunir de la chaleur, on contribue au réchauffement...
Un cercle vicieux qu'il est vital de briser pour les « bioclimatiques ». Olivier Sidler dirige un cabinet d'étude spécialisé dans les bâtiments à faible consommation d'énergie. «On ne peut pas climatiser la terre entière. Il faut penser autrement, changer nos modes de vie avant qu'il soit trop tard. Et d'abord concevoir des bâtiments intelligents avant d'installer des clims à tout va.» Depuis 2000, la réglementation française du bâtiment valorise les conceptions bioclimatiques pour améliorer le confort pendant l'été en évitant le recours à la climatisation : toitures végétales, panneaux et capteurs solaires, isolation thermique... Des innovations loin des préoccupations des skieurs de Ski Dubai, station de sports d'hiver plantée au coeur du désert des Emirats arabes unis : 22 500 mètres carrés recouverts de 6 000 tonnes de neige et une batterie de climatiseurs qui tournent à plein régime pour maintenir la température au-dessous de zéro. Sous l'oeil des chameaux.
6. Vers un paysage transformé ?
La chaleur et la sécheresse affligent certaines espèces et en favorisent d'autres. Depuis plusieurs années déjà, différents spécialistes ont observé des modifications dans les aires de répartition de plusieurs espèces animales ou végétales. L'Australienne Camille Parmesan a noté une remontée vers le nord de nombreux oiseaux, papillons et plantes de montagne. A l'Inra, Antoine Kremer prévoit, lui, toujours vers le nord, une migration du chêne, qui a engagé une sorte de course-poursuite avec le thermomètre et commencé à se propager vers les hautes latitudes en quête de la relative fraîcheur qu'il affectionne. De même, tous les spécialistes estiment que la répartition du hêtre va basculer complètement en un siècle, du centre-sud-ouest vers le nord-est. D'une façon générale, le réchauffement allonge le printemps et l'automne, donc la saison feuillue. Tandis que le CO2 favorise la végétation et accélère sa croissance. Il constitue en effet une sorte de fertilisant, qui améliore l'efficacité de la photosynthèse. D'où l'augmentation de la couverture forestière, qui a retrouvé aujourd'hui son étendue du Moyen Age. Les chercheurs estiment que la production de bois sera accrue de 40% avec le doublement attendu du taux atmosphérique de CO2 en 2100. Seul bémol dans cette promesse d'une sorte d'âge d'or forestier : le bois poussé plus vite risque d'être de moins bonne qualité. Et la hausse moyenne du thermomètre pourrait favoriser certaines maladies des végétaux. Ainsi que les incendies de forêt...
Un cercle vicieux qu'il est vital de briser pour les « bioclimatiques ». Olivier Sidler dirige un cabinet d'étude spécialisé dans les bâtiments à faible consommation d'énergie. «On ne peut pas climatiser la terre entière. Il faut penser autrement, changer nos modes de vie avant qu'il soit trop tard. Et d'abord concevoir des bâtiments intelligents avant d'installer des clims à tout va.» Depuis 2000, la réglementation française du bâtiment valorise les conceptions bioclimatiques pour améliorer le confort pendant l'été en évitant le recours à la climatisation : toitures végétales, panneaux et capteurs solaires, isolation thermique... Des innovations loin des préoccupations des skieurs de Ski Dubai, station de sports d'hiver plantée au coeur du désert des Emirats arabes unis : 22 500 mètres carrés recouverts de 6 000 tonnes de neige et une batterie de climatiseurs qui tournent à plein régime pour maintenir la température au-dessous de zéro. Sous l'oeil des chameaux.
6. Vers un paysage transformé ?
La chaleur et la sécheresse affligent certaines espèces et en favorisent d'autres. Depuis plusieurs années déjà, différents spécialistes ont observé des modifications dans les aires de répartition de plusieurs espèces animales ou végétales. L'Australienne Camille Parmesan a noté une remontée vers le nord de nombreux oiseaux, papillons et plantes de montagne. A l'Inra, Antoine Kremer prévoit, lui, toujours vers le nord, une migration du chêne, qui a engagé une sorte de course-poursuite avec le thermomètre et commencé à se propager vers les hautes latitudes en quête de la relative fraîcheur qu'il affectionne. De même, tous les spécialistes estiment que la répartition du hêtre va basculer complètement en un siècle, du centre-sud-ouest vers le nord-est. D'une façon générale, le réchauffement allonge le printemps et l'automne, donc la saison feuillue. Tandis que le CO2 favorise la végétation et accélère sa croissance. Il constitue en effet une sorte de fertilisant, qui améliore l'efficacité de la photosynthèse. D'où l'augmentation de la couverture forestière, qui a retrouvé aujourd'hui son étendue du Moyen Age. Les chercheurs estiment que la production de bois sera accrue de 40% avec le doublement attendu du taux atmosphérique de CO2 en 2100. Seul bémol dans cette promesse d'une sorte d'âge d'or forestier : le bois poussé plus vite risque d'être de moins bonne qualité. Et la hausse moyenne du thermomètre pourrait favoriser certaines maladies des végétaux. Ainsi que les incendies de forêt...

7. La sécheresse, une conséquence inéluctable ?
Pour la France, tous les modèles théoriques le montrent : le réchauffement climatique va s'accompagner d'un accroissement des précipitations l'hiver et de leur diminution l'été. En moyenne totale, il y aura peut-être toujours autant de pluie, mais elle tombera surtout quand on en a le moins besoin. Ainsi l'été, d'ici à 2050, selon le modèle de prévision Arpège de Météo France, le nombre maximal de jours consécutifs sans pluie augmentera sur toutes les régions et dépassera la durée moyenne de 3 semaines sur plus de la moitié du territoire. En outre les pluies de saison chaude, apparaissant de plus en plus à la faveur d'orages violents, déferlent de façon massive : au lieu de percoler doucement dans le sol, elles occasionnent des dégâts en surface. La sécheresse, en la faisant souffrir, diminue l'aptitude de la végétation à piéger le CO2, ce qui accroît l'effet de serre... et donc la sécheresse. De plus - autre rétroaction perverse -, les agriculteurs sont incités à irriguer en pompant davantage dans les rivières, ce qui évidemment n'arrange rien. Par-dessus le marché, la France, championne d'Europe de l'irrigation, est lanterne rouge en matière de puissance de calcul informatique - laquelle se mesure en teraflops (mille milliards d'opérations par seconde). Pour modéliser toutes ces interactions climatiques complexes, nous n'en disposons que de 14, alors que l'Espagne en a 40, l'Allemagne 90 et le Royaume-Uni pas moins de 100. Bref, la France n'affiche pas seulement un déficit en eau, elle manque aussi cruellement de teraflops...
8. Quelles conséquences sur le tourisme ?
Miser sur la résidence secondaire sur le Spitzberg ? Réserver tout de suite un camping sur la banquise pour 2020 ? C'est à voir. Les professionnels du tourisme interrogés sont plus prudents. Il est vrai que la pédagogie n'est pas facile. «Ainsi, explique Christian Mantei, de l'ODIT (l'organisme qui s'occupe d'observations et d'ingénierie touristiques pour le ministère du Tourisme), l'an dernier nous avons essayé de sensibiliser les professionnels de la montagne aux risques à terme du réchauffement climatique. Ça a été très compliqué : la saison a été magnifique et la neige plus abondante que jamais...» On est dans un domaine très réactif et difficile à analyser. On estime que l'année 2003 a apporté un million de nuitées supplémentaires à la Bretagne, mais comme la Bretagne plaît de plus en plus d'année en année, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit dû à la canicule. Sans avoir encore les chiffres précis, on sait que les professionnels de Normandie et de Bretagne sont contents de juillet 2006, mais on sait aussi que la montagne, l'été, continue à être le seul « espace touristique un peu en retrait », selon l'euphémisme de rigueur. Et pourtant, quoi de mieux que les cimes pour respirer un peu ?
A défaut d'être le seul critère de choix, la météo peut devenir un argument commercial. Ainsi le président du Snav (syndicat des agents de voyage), qui cherche à relancer la pauvre Réunion, laissée à terre par l'épidémie de chikungunya, vante les douceurs du climat insulaire durant l'hiver austral - c'est-à-dire notre été : «Allez-y! 24-25° et un petit vent frais, c'est parfait!» Quant à savoir si, demain, dans le choix des vacances, le nouveau climat sera tout ? Même les écologistes hésitent. L'un des enjeux essentiels sera la gestion des ressources hydriques, déjà à la limite de leur capacité dans beaucoup d'endroits du littoral pour approvisionner des vacanciers deux fois plus gourmands en eau que durant l'année. Maison ne sait comment cela se traduira. Un rapport présenté sur le site de Greenpeace évoque l'éventualité d'un « tourisme de fraîcheur »modifiant le calendrier des vacances (des voyages plutôt au printemps ou en automne que l'été), sans plus de précision. Il souligne aussi que la lutte contre les gaz à effet de serre nous incitera à modérer notre consommation de transport aérien. Proximité et fraîcheur : Nord-Pas-de-Calais, réveille-toi, ta chance est peut-être venue !
8. Quelles conséquences sur le tourisme ?
Miser sur la résidence secondaire sur le Spitzberg ? Réserver tout de suite un camping sur la banquise pour 2020 ? C'est à voir. Les professionnels du tourisme interrogés sont plus prudents. Il est vrai que la pédagogie n'est pas facile. «Ainsi, explique Christian Mantei, de l'ODIT (l'organisme qui s'occupe d'observations et d'ingénierie touristiques pour le ministère du Tourisme), l'an dernier nous avons essayé de sensibiliser les professionnels de la montagne aux risques à terme du réchauffement climatique. Ça a été très compliqué : la saison a été magnifique et la neige plus abondante que jamais...» On est dans un domaine très réactif et difficile à analyser. On estime que l'année 2003 a apporté un million de nuitées supplémentaires à la Bretagne, mais comme la Bretagne plaît de plus en plus d'année en année, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit dû à la canicule. Sans avoir encore les chiffres précis, on sait que les professionnels de Normandie et de Bretagne sont contents de juillet 2006, mais on sait aussi que la montagne, l'été, continue à être le seul « espace touristique un peu en retrait », selon l'euphémisme de rigueur. Et pourtant, quoi de mieux que les cimes pour respirer un peu ?
A défaut d'être le seul critère de choix, la météo peut devenir un argument commercial. Ainsi le président du Snav (syndicat des agents de voyage), qui cherche à relancer la pauvre Réunion, laissée à terre par l'épidémie de chikungunya, vante les douceurs du climat insulaire durant l'hiver austral - c'est-à-dire notre été : «Allez-y! 24-25° et un petit vent frais, c'est parfait!» Quant à savoir si, demain, dans le choix des vacances, le nouveau climat sera tout ? Même les écologistes hésitent. L'un des enjeux essentiels sera la gestion des ressources hydriques, déjà à la limite de leur capacité dans beaucoup d'endroits du littoral pour approvisionner des vacanciers deux fois plus gourmands en eau que durant l'année. Maison ne sait comment cela se traduira. Un rapport présenté sur le site de Greenpeace évoque l'éventualité d'un « tourisme de fraîcheur »modifiant le calendrier des vacances (des voyages plutôt au printemps ou en automne que l'été), sans plus de précision. Il souligne aussi que la lutte contre les gaz à effet de serre nous incitera à modérer notre consommation de transport aérien. Proximité et fraîcheur : Nord-Pas-de-Calais, réveille-toi, ta chance est peut-être venue !

9. A qui profite la chaleur ?
Sous toutes ses formes, l'eau est, avec la climatisation, la grande gagnante de la canicule. Sauf évidemment pour les nappes et rivières. Sinon, glacée sous forme de sorbets, pour humains ou animaux, en bouteille ou en piscine, H2O est la star de demain. Passé une certaine température, elle profite bien plus que la bière de la soif régnante. Les ventes de distributeurs d'eau ont fait un bond de 20% depuis le début de l'épisode caniculaire, frôlant parfois la rupture de stock. Après les ventilateurs, héros de la sécheresse de 1976, les climatiseurs, vedettes de 2003, l'objet 2006 est le brumisateur. Au grand profit de l'entreprise Dutrie, dans la Drôme, qui attend une augmentation de 30% de son chiffre d'affaires. A la terrasse des cafés, des restaurants, dans les crèches, les maisons de retraite, les entreprises agricoles, sur les plages même, on s'arrache ses brumisateurs géants qui pulvérisent des gouttelettes d'eau parfois parfumée aux huiles essentielles.
Autre petite entreprise en pleine expansion du fait de la chaleur : Climpact, créée par trois chercheurs du CNRS, vend aux grands de l'agroalimentaire des « indices » et projections qui leur permettent d'ajuster leurs fabrications et leurs stocks en fonction de la température prévue. Exemple : sur le grand Sud-Est, ces mathématiciens et informaticiens ont calculé qu'une augmentation de 1 degré de la moyenne mensuelle des températures entraînait une vente supplémentaire de 1,5 million de litres de soda par mois. Grâce à cet outil statistique, les entreprises peuvent éviter les ruptures de stocks, synonymes de pénalités à payer aux distributeurs ou, pis encore, de déréférencement. Signe de l'influence du climat sur la santé de cette petite société, elle va vendre dès la rentrée des outils permettant d'anticiper sur un mois l'impact des prévisions météo sur la consommation. A l'autre bout de la chaîne technologique, les vendeurs à la sauvette du métro parisien ont trouvé leur niche commerciale : les éventails font fureur.
10. Comment font les autres ?
L'Europe sue à grosses gouttes. Grande-Bretagne, Pays-Bas, Autriche, Italie, Espagne... Du Nord au Sud, difficile d'échapper à la canicule. Et à ses morts. Plus de 80, selon un bilan provisoire. En tête de liste, la France. «Il n'est pas juste de dire que la France a plus de morts que les autres pays européens», s'insurge le directeur de l'Institut de Veille sanitaire, Gilles Brücker. Et d'expliquer ces différences statistiques par la «réactivité» du système, qui permet de connaître très vite les données de la mortalité, contrairement aux autres.
Sécheresse, pollution, coupures d'électricité, inondations... Les dégâts se ressemblent d'un pays à l'autre. Les Européens s'adaptent tant bien que mal à cette nouvelle donne climatique. A l'image de la Grande-Bretagne. Au pays du crachin, le record de température au mois de juillet a été battu avec un 36,3 °C dans le sud de Londres. Les Anglais modifient du coup leur comportement. Les jardins publics remplacent les classiques bégonias et géraniums par de la lavande et des cactus, moins friands en eau. Le dress code laisse également à désirer. Certaines entreprises tolèrent shorts et sandales ! Plus difficile à imaginer, 77% des employés seraient, selon un sondage, prêts à feindre la maladie pour profiter des beaux jours...
Les Espagnols, habitués aux grosses chaleurs, adaptent leur mode de vie à la période estivale. Comme dit le dicton : «Neuf mois d'hiver, trois mois d'enfer.» Madrid se vide entre 14 et 17 heures, les uns s'enfermant dans les restaurants ou boutiques climatisés, les autres ne dérogeant pas à la sieste. La vente d'éventails connaît aussi un boom sans précédent. Les hommes ne se sépareraient plus de cet accessoire très Lagerfeld...
En Italie, la sécheresse a déjà coûté 500 millions d'euros à l'agriculture. Les touristes bravent la chaleur et se rafraîchissent dans les fontaines publiques. Mais pour Pascale, une Française de Milan, la révolution estivale est ailleurs : les mammas ont remisé au placard leurs collants... Tout se perd.
Autre petite entreprise en pleine expansion du fait de la chaleur : Climpact, créée par trois chercheurs du CNRS, vend aux grands de l'agroalimentaire des « indices » et projections qui leur permettent d'ajuster leurs fabrications et leurs stocks en fonction de la température prévue. Exemple : sur le grand Sud-Est, ces mathématiciens et informaticiens ont calculé qu'une augmentation de 1 degré de la moyenne mensuelle des températures entraînait une vente supplémentaire de 1,5 million de litres de soda par mois. Grâce à cet outil statistique, les entreprises peuvent éviter les ruptures de stocks, synonymes de pénalités à payer aux distributeurs ou, pis encore, de déréférencement. Signe de l'influence du climat sur la santé de cette petite société, elle va vendre dès la rentrée des outils permettant d'anticiper sur un mois l'impact des prévisions météo sur la consommation. A l'autre bout de la chaîne technologique, les vendeurs à la sauvette du métro parisien ont trouvé leur niche commerciale : les éventails font fureur.
10. Comment font les autres ?
L'Europe sue à grosses gouttes. Grande-Bretagne, Pays-Bas, Autriche, Italie, Espagne... Du Nord au Sud, difficile d'échapper à la canicule. Et à ses morts. Plus de 80, selon un bilan provisoire. En tête de liste, la France. «Il n'est pas juste de dire que la France a plus de morts que les autres pays européens», s'insurge le directeur de l'Institut de Veille sanitaire, Gilles Brücker. Et d'expliquer ces différences statistiques par la «réactivité» du système, qui permet de connaître très vite les données de la mortalité, contrairement aux autres.
Sécheresse, pollution, coupures d'électricité, inondations... Les dégâts se ressemblent d'un pays à l'autre. Les Européens s'adaptent tant bien que mal à cette nouvelle donne climatique. A l'image de la Grande-Bretagne. Au pays du crachin, le record de température au mois de juillet a été battu avec un 36,3 °C dans le sud de Londres. Les Anglais modifient du coup leur comportement. Les jardins publics remplacent les classiques bégonias et géraniums par de la lavande et des cactus, moins friands en eau. Le dress code laisse également à désirer. Certaines entreprises tolèrent shorts et sandales ! Plus difficile à imaginer, 77% des employés seraient, selon un sondage, prêts à feindre la maladie pour profiter des beaux jours...
Les Espagnols, habitués aux grosses chaleurs, adaptent leur mode de vie à la période estivale. Comme dit le dicton : «Neuf mois d'hiver, trois mois d'enfer.» Madrid se vide entre 14 et 17 heures, les uns s'enfermant dans les restaurants ou boutiques climatisés, les autres ne dérogeant pas à la sieste. La vente d'éventails connaît aussi un boom sans précédent. Les hommes ne se sépareraient plus de cet accessoire très Lagerfeld...
En Italie, la sécheresse a déjà coûté 500 millions d'euros à l'agriculture. Les touristes bravent la chaleur et se rafraîchissent dans les fontaines publiques. Mais pour Pascale, une Française de Milan, la révolution estivale est ailleurs : les mammas ont remisé au placard leurs collants... Tout se perd.
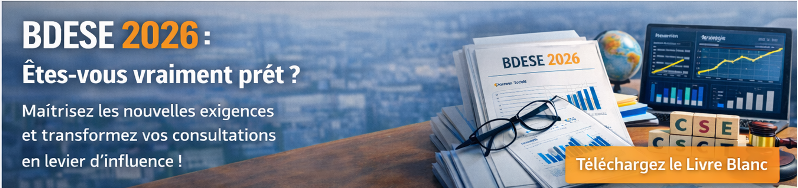

 Accueil
Accueil











